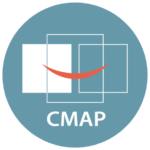* Cet article a été rédigé sur la base du droit en vigueur à la date de sa publication. Une réforme étant actuellement discutée, notamment à la suite de la remise en mars 2025 du rapport du Groupe de travail sur la réforme du droit français de l’arbitrage établi sous l’égide du ministère de la justice, certaines règles pourraient évoluer.
L’obtention d’une sentence arbitrale favorable est une victoire majeure dans le processus engagé par le créancier, d’autant plus qu’elle intervient au terme d’une procédure souvent rigoureuse et exigeante. Mais pour que la victoire soit entière, encore faut-il en obtenir l’exécution dans les meilleurs délais, si le débiteur ne devait pas s’exécuter spontanément.
Cet article propose cinq réflexes à adopter pour aborder sereinement cette étape ultime, anticiper les éventuelles difficultés et maximiser les chances de succès dans le recouvrement des fonds.
Réflexe n° 1 : Analyser la solvabilité du débiteur avant d’initier la procédure d’arbitrage
Si la phase d’exécution est considérée comme la dernière phase d’une procédure d’arbitrage, elle se prépare en réalité avant même d’initier l’arbitrage, en évaluant la solvabilité du débiteur. Non seulement cela permet de juger de l’opportunité d’engager une telle procédure, mais elle permet aussi de sonder l’opportunité (i) de joindre à la procédure la société-mère si le débiteur direct devait s’avérer une coquille vide et (ii) de diligenter des mesures conservatoires très tôt dans la procédure en cas de risque de dissipation des actifs du débiteur.
Cette analyse de solvabilité peut se faire via une simple consultation de l’état des sûretés et comptes annuels des derniers exercices de la société ainsi que la mise en place de « veilles » sur le débiteur tout au long de la procédure. Pour certaines affaires plus complexes, notamment lorsque les biens saisissables sont moins facilement indentifiables – parce que situés dans des pays moins transparents –, il peut être nécessaire de mettre en place, via des tiers professionnels, une recherche d’actifs visant à identifier, localiser et inventorier les biens du débiteur.
Cette « enquête » permet ainsi d’identifier les pays potentiels d’exécution et d’évaluer si leur régime juridique est propice à l’accueil des sentences arbitrales, en regardant notamment si l’État est partie à la Convention de New York du 10 juin 1958, laquelle offre un cadre juridique uniforme de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales.
Cette phase est essentielle et c’est d’ailleurs une des étapes préliminaires sollicitées par les tiers financeurs, dont l’engagement financier dépend de la solvabilité du débiteur et de la facilité d’exécution.
Réflexe n° 2 : Formuler des demandes précises et « exécutables » dans le cadre de la procédure d’arbitrage
Pendant la procédure arbitrale, il est important de formuler précisément ses demandes puisqu’une sentence arbitrale n’est réellement efficace que si elle peut faire l’objet de mesures d’exécution. Or, son efficacité dépend directement de la manière dont les demandes sont formulées devant le tribunal arbitral, ce dernier étant tenu par les seules demandes des parties[1].
A cette fin, il est vivement conseillé de reprendre toutes les demandes dans le dispositif des mémoires. Bien que la présence d’un dispositif dans les écritures ou dans la sentence ne soit pas imposée en droit français de l’arbitrage[2], l’expérience montre combien il peut être risqué de s’en passer. A tout le moins, cela peut créer des difficultés – inutiles – lors de l’exécution. Plus les demandes seront lisibles dans les mémoires, plus il sera simple pour les arbitres de rendre une sentence avec un dispositif clair, permettant ainsi de limiter au mieux les difficultés d’exécution. Le dispositif est ainsi en quelque sorte la « colonne vertébrale » de la sentence dont il faut prendre soin.
Non seulement ces demandes doivent être, idéalement, reprises intégralement dans le dispositif, mais plus encore, elles doivent être claires et précises. Il convient donc d’éviter les formulations vagues ou qui peuvent mettre en risque l’exécution. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 juin 2018 qu’une sentence fixant le prix de cession d’actions sans condamner explicitement l’acquéreur au paiement ne permettait pas une saisie-attribution à hauteur de ce prix[3].
Enfin, il est essentiel de lister de manière exhaustive ses demandes, en sollicitantles accessoires de la créance principale – tel que les intérêts avec le taux applicable, le point départ, la capitalisation et les éventuelles majorations mais également l’astreinte – ou encore l’exécution provisoire, en cas d’arbitrage interne[4], les recours étant en principe suspensifs[5], contrairement à l’arbitrage international[6]. Certes, si l’exécution provisoire n’a pas été demandée aux arbitres, il reste possible de saisir le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, pour l’obtenir[7], mais cette faculté est soumise à leur pouvoir d’appréciation et retarde nécessairement l’exécution de la sentence.
Réflexe n° 3 : Vérifier le contenu de la sentence
Une fois la sentence reçue, il est crucial d’en vérifier le contenu afin de s’assurer de l’absence d’erreur matérielle, omission, contrariété ou ambiguïté qui pourrait compliquer son exécution. Ainsi, trois vérifications sont essentielles : (i) s’assurer que toutes les demandes ont été tranchées (absence d’infra petita), (ii) vérifier qu’aucune erreur matérielle (par exemple de calcul ou de rédaction) ni ambiguïté ne figure dans la sentence et (iii) évaluer la clarté, la précision et la complétude du dispositif de la sentence, et notamment que les montants, les bénéficiaires et débiteurs sont clairement déterminés.
Cette analyse doit être impérativement faite dans un délai très court à réception de la sentence : le délai imparti pour soumettre une demande de rectification, interprétation ou complétion de la sentence est de 3 mois à compter de la notification de la sentence, en droit français[8] ou, à compter de la communication de la sentence par le secrétariat selon l’article 32 du règlement d’arbitrage du CMAP en vigueur depuis le 1er février 2025. D’autres règlements d’arbitrage sont encore plus exigeants en prévoyant par exemple un délai de 30 jours à compter de la communication de la sentence.
Réflexe n° 4 : Solliciter l’exequatur sans délai
Une fois les vérifications formelles de la sentence effectuées, l’exécution à proprement parler peut être initiée. Elle commencera avec l’exequatur de la sentence, préalable nécessaire avant toute mesure d’exécution, à l’exception des mesures conservatoires qui peuvent être mises en œuvre sur la base d’une sentence non encore revêtue de l’exequatur[9].
Si la procédure d’exequatur est relativement simple et rapide en France – procédure non contradictoire sur requête, devant le tribunal judiciaire du lieu du siège ou celui de Paris pour une sentence rendue à l’étranger, avec un simple dépôt auprès du greffe dudit tribunal de l’original de la sentence, avec sa traduction assermentée si elle n’est pas en langue française, ainsi que la copie de la convention d’arbitrage, environ quelques semaines –, cette procédure n’est pas aussi simple devant les juridictions étrangères, qui prévoient parfois une procédure contradictoire et donc des délais prolongés. Il est donc vivement recommandé d’anticiper le lieu d’exécution pour prendre les mesures nécessaires le jour de réception de la sentence.
Le première chose est donc de s’assurer si en l’espèce, l’exécution immédiate est possible : tel est le cas, en France, en arbitrage international – le recours en annulation n’étant pas suspensif[10] – ou, en arbitrage interne, si la sentence est assortie de l’exécution provisoire[11]. Nous rappellerons que dans ces deux cas, l’exécution immédiate peut être suspendue ou aménagée dans des conditions strictes : en cas risque de conséquences manifestement excessives (en arbitrage interne)[12] ou de lésion grave des droits d’une partie (en arbitrage international)[13].
Si l’exécution immédiate est possible, et s’il existe un risque de non-recouvrement – par exemple risque de procédure collective ou dissipation des biens du débiteur – il est essentiel de déposer la requête d’exequatur au plus tôt pour l’obtenir avant tout recours en annulation. En effet, ce recours dessaisit le juge de l’exequatur[14] et par conséquent, si un recours en annulation est introduit avant que ce dernier n’ait rendu son ordonnance, le créancier devra déposer une nouvelle demande devant le premier président de la cour d’appel saisie du recours ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état – pour obtenir l’exequatur, ce qui retarde le processus[15].
En revanche, cette célérité ne doit pas rimer avec précipitation. Il est nécessaire d’évaluer le moment opportun pour déposer une requête en exequatur : en effet, l’exécution immédiate de la sentence, c’est-à-dire sans attendre l’expiration du délai de recours en annulation ni son issue, peut avoir des conséquences majeures en cas d’annulation de la sentence exécutée. Le créancier devra alors restituer les sommes et répondre des conséquences dommageables engendrées par l’exécution[16].
Réflexe n° 5 : Sécuriser la signification et diligenter les mesures d’exécution forcée
Une fois la sentence revêtue de l’exequatur, il convient alors de la signifier, préalable nécessaire à toute mesure d’exécution[17]. Nous préciserons que si le créancier préfère finalement attendre l’issue du recours en annulation avant d’obtenir l’exequatur et exécuter la sentence, il devra dans tous les cas signifier la sentence – non revêtue de l’exequatur – afin de faire courir le délai du recours en annulation[18].
Une fois les actifs identifiés ou mis à jour si une recherche d’actifs a été réalisé en amont de la procédure arbitrale, le créancier pourra alors diligenter les mesures telles que prévues par le code des procédures civiles d’exécution du lieu des actifs.
Un conseil lors de cette phase d’exécution : collaborer au plus près avec les commissaires de justice et s’assurer de la régularité des actes d’exécution, en veillant par exemple à ce que toutes les mentions obligatoires – requises sous peine de nullité et de libération des biens saisis – figurent dans le procès-verbal de saisie. La vérification du respect des délais est également cruciale : en cas de saisie-attribution, par exemple, la dénonciation au débiteur doit intervenir dans les huit jours suivant la signification au tiers détenteur[19].
En bref, réussir l’exécution d’une sentence arbitrale ne s’improvise pas, elle se prépare dès l’origine du litige et les bons réflexes sont essentiels pour obtenir un résultat tangible.
[1] Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, Domat, 2019, 2019, § 824 ; Article 1492 3° pour l’arbitrage interne et article 1520 3° pour l’arbitrage international.
[2] Cass. civ. 2e, 25 mars 1999, n° 97-15.679 ; Cour d’Appel de Paris, 13 avril 2021, n° 18/17862.
[3] Civ. 2ème, 28 juin 2018, n°17-17.340.
[4] Article 1496 du code de procédure civile, ci-après « CPC » – Ceci étant dit, le rapport du Groupe de travail sur la réforme du droit français de l’arbitrage remis en mars 2025 (proposition n° 33) propose de supprimer cet effet suspensif, alignant ainsi l’arbitrage interne sur le régime international et renforçant l’efficacité des sentences. Affaire à suivre donc.
[5] Article 1496 du code de procédure civile, ci-après « CPC » – Ceci étant dit, le rapport du Groupe de travail sur la réforme du droit français de l’arbitrage remis en mars 2025 (proposition n° 33) propose de supprimer cet effet suspensif, alignant ainsi l’arbitrage interne sur le régime international et renforçant l’efficacité des sentences. Affaire à suivre donc.
[6] Article 1526 du CPC.
[7] Article 1497 2° du CPC.
[8] Articles 1485 alinéas 2 et 3 et 1486 du CPC, applicable à l’arbitrage international sur renvoi de l’article 1506 4° dudit code. En application de l’article 1484 du CPC, la sentence « est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement ».
[9] Civ. 2ème, 12 octobre 2006, n° 04-19.062.
[10] Article 1526 du CPC.
[11] Article 1496 du CPC.
[12] Article 1497 1° du CPC.
[13] Article 1526 alinéa 2 du CPC.
[14] Article 1499 alinéa 2 du CPC (arbitrage interne) et article 1524 du CPC (arbitrage international).
[15] Article 1498 alinéa 1 du CPC (arbitrage interne) et article 1521 du CPC (arbitrage international).
[16] Article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
[17] Article 503 du CPC.
[18] Articles 1484 et 1494 du CPC (arbitrage interne) ; Article 1519 alinéa 3 du CPC (arbitrage international).
[19] Article R.211-3 du CPCE.

Caroline Duclercq
Avocate Associée
Medici Law

Valérie Kasparian
Avocate
Medici Law