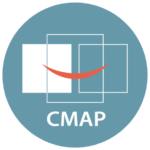Merci Chloé Enkoua de nous avoir ouvert les colonnes de la Gazette du Palais pour cet entretien avec Sophie Henry, déléguée générale du CMAP
Le Centre de médiation et d’arbitrage de paris (CMAP) a publié les résultats de son baromètre pour l’année 2024. Un principal constat : la médiation est de plus en plus perçue comme un outil stratégique, notamment pour les entreprises. Explications avec Sophie Henry et Bérangère Clady, respectivement déléguée générale et directrice du pôle MARD du CMAP.

Gazette du Palais : Quels sont les principaux chiffres et enseignements de cette nouvelle édition du baromètre du CMAP (https://lext.so/CBUgQn) ?
Bérangère Clady : En tout, 2 382 médiations ont été traitées en 2024, soit un chiffre en hausse de 5 % par rapport à 2023. 451 d’entre elles concernaient des litiges inter-entreprises, ce qui représente une progression de 19 % par rapport à l’année précédente. À noter également que les saisines fondées sur des clauses de médiation représentent 74 % des dossiers ; là aussi, c’est une augmentation de 15 points par rapport à l’an passé. C’est pour nous la preuve que les entreprises intègrent de plus en plus la médiation dans leurs pratiques contractuelles, en amont des conflits. Par ailleurs, le recours aux modes amiables s’étend désormais sur tout le territoire français : 41 % des médiations traitées par le centre ont en effet impliqué au moins une partie issue des régions, contre 40 % en 2023 et 29 % en 2022. C’est une évolution majeure qui s’explique selon nous pour deux raisons principales : la mobilisation croissante des juridictions locales qui ont de plus en plus recours à la médiation, mais aussi la présence nationale des médiateurs du CMAP. S’agissant de l’arbitrage, nous avons traité une vingtaine de dossiers en 2024. Les entreprises nous ont saisis sur des dossiers très variés, aussi bien nationaux qu’internationaux et avec pour certains des enjeux financiers très élevés – plusieurs centaines de millions d’euros –, rendant l’issue de ces procédures d’arbitrage plus que jamais stratégique pour la vie des entreprises.
GPL : Quelle a été la part de médiations judiciaires et de médiations conventionnelles ?
B. Clady : Les médiations conventionnelles représentent 57,46 % des dossiers, contre un peu plus de 42 % pour les médiations judiciaires. Cela met en évidence la montée en puissance de la médiation conventionnelle commerciale, qui représente désormais 53 % des saisines contre 51 % en 2023. C’est une évolution assez naturelle qui s’illustre notamment par le signal des saisines sur clause : on anticipe désormais au point d’insérer des clauses dans les contrats.
GPL : Où en est-on des délais et des coûts de la médiation ?
B. Clady : En 2024, la durée moyenne des médiations était de 12 heures, contre 14 en 2023. Il s’agit d’une donnée assez stable depuis plusieurs années qui démontre l’efficacité du processus, y compris dans un contexte de hausse du nombre de dossiers et d’enjeux financiers croissants. Le coût moyen de 6 500 € (contre 7 000 € en 2023) reste là aussi globalement assez stable et montre que la médiation est une solution économiquement compétitive. De manière globale, 76 % des dossiers traités par le centre ont un coût inférieur à 10 000 €, dont un tiers avec un coût inférieur à 3 000 €.
GPL : Quels sont les secteurs d’activité qui ont aujourd’hui le plus recours à la médiation ?
B. Clady : La répartition sectorielle reste très éclatée, ce qui reflète la transversalité croissante de notre compétence. Trois principaux secteurs se détachent malgré tout : la distribution et la franchise (20 %), la construction (11 %), et l’énergie (10 %). Ce sont des secteurs qui partagent une caractéristique commune. A savoir des chaînes contractuelles assez longues, des partenariats sensibles et une forte pression, aussi bien juridique qu’économique et opérationnelle. Des terrains propices à la médiation, tant pour préserver les relations commerciales que pour éviter des contentieux longs et exposés.
GPL : Comment expliquez-vous ce changement culturel et de perception de la médiation, notamment en ce qui concerne les entreprises ?
Sophie Henry : Faire évoluer la mentalité des entreprises concernant la médiation est un sujet sur lequel le CMAP travaille depuis 20 ans. Outre le fait que la Chancellerie met depuis quelque temps un point d’honneur à développer davantage les modes amiables, on sent aujourd’hui une prise en considération accrue de la médiation. Le changement culturel s’opère donc enfin, avec des conséquences sur les entreprises qui en entendaient autrefois parler mais qui n’étaient peut-être pas encore tout à fait enclines à intégrer ces modes amiables dans leurs pratiques. Je pense que la médiation a désormais acquis ses titres de noblesse et représente à leurs yeux un mode de résolution agile, confidentiel et adapté à leurs enjeux économiques. Cela conforte notre rôle de partenaire stratégique pour la sécurisation des relations d’affaires et pour la maîtrise des contentieux de ces entreprises, qui hésitent beaucoup moins à nous solliciter qu’auparavant.